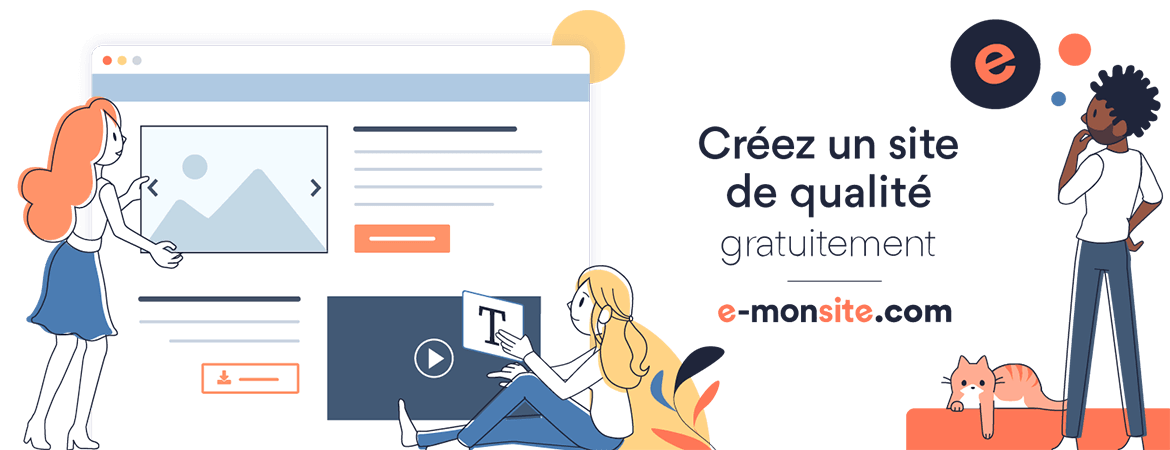Languedoc-Roussillon
Millas Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussilon
![]() francal
15/10/2012
francal
15/10/2012
Millas est une commune française située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon. Ses habitants sont appelés les Millassois.
Commune située en Ribéral sur la route nationale 116 entre Prades et Perpignan, au confluent de la Têt et du Boulès.
Histoire
Le nom de « Millas » paraît avoir deux explications possibles. D’une part, ses racines pourraient provenir de l'existance d’une borne milliaire au bord d'une voie romaine (Milar en catalan). Une autre théorie rattache son origine à la grande quantité de mil ("mill" en catalan) produite au Moyen Age par les villageois.
Cette deuxième interprétation est, sans doute, la plus plausible si l'on en croit le blason de la Ville qui représente une plante semblable à un épi de millet. Le nom "Millares" apparaît pour la première fois en 898 dans un texte mentionnant une prise d’eau et un canal. Daté de 953, un autre document laisse apparaître le nom latinisé de "Miliaso".
Le territoire de Millas a été habité dès l'époque néolithique.
Le village originel date du premier âge du fer comme en témoignent les traces archéologiques d'un cimetière de la civilisation des champs d'urnes, découvertes il y a une cinquantaine d'années.
Située à 97 mètres au dessus du niveau de la mer, Millas compte aujourd'hui 3 951 habitants (2010) et la Commune s'étend sur 1 912 hectares, en plein centre du Roussillon (Pyrénées Orientales).
La Féria de Millas
La ville est membre du l'Union des villes taurines françaises.
Les Grandes Canalettes Pyrénées-Orienales Languedoc-Roussilon
![]() francal
15/10/2012
francal
15/10/2012
La grotte se compose de deux parties, la Galerie Des Deux Porches qui conduit à la Salle Blanche et le Réseau d'Angkor qui comprend La Nef, le Lac aux Atolls, la Salle d'Angkor et la Salle du Dôme Rouge. Elle offre ainsi, au fur et à mesure de la visite, une suite ininterrompue d'édifices aux volumes grandissants jusqu'au magnifique belvédère du Balcon des Ténèbres.
Tous les soirs, en juillet et août à 18h30, spectacle musical son et lumière.
En 1978, le hasard d'une conférence lui fit rencontrer Edmond Delonca, alors foreur de son état. La passion de l'hydrogéologie et de la spéléologie, associée à la perspective de redécouvrir le réseau de Fuilla et d'Angkor, devait réunir les deux hommes et sceller une belle amitié.
| L'exploration permit la découverte de la Salle Blanche le 8 mai 1982 et l'aménagement de la grotte. La grotte se compose de deux parties, la Galerie Des Deux Porches qui conduit à la Salle Blanche et le Réseau d'Angkor qui comprend La Nef, le Lac aux Atolls, la Salle d'Angkor et la Salle du Dôme Rouge. |
| Elle offre ainsi, au fur et à mesure de la visite, une suite ininterrompue d'édifices aux volumes grandissants jusqu'au magnifique belvédère du Balcon des Ténèbres. La grotte des Grandes Canalettes renferme une collection rare de concrétions excentriques qui arrêtent toujours les pas du spéléologue le plus blasé et étonnent les amateurs de grottes aménagées. |
sur la route de Corneilla de Conflent et Vernet les Bains, dans les Pyrénées-Orientales.
Les Grandes Canalettes figurent aujourd'hui parmi les plus belles grottes de France et sont l'un des sites les plus visités dans les Pyrénées-Orientales.
Prades Pyrénées-Orientales Languedoc-Roussillon
![]() francal
11/10/2012
francal
11/10/2012
Prades (en catalan Prada) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales et la région Languedoc-Roussillon.
Ses habitants sont appelés les Pradéens.
Prades se situe en Conflent dont elle est la principale ville, au pied du massif du Canigou, à 40 kilomètres à l'ouest de Perpignan, sur la rive droite de la Têt.
Transports
La route nationale 116, qui relie Perpignan à Bourg-Madame (en Cerdagne) contourne la ville par le nord.
La ville bénéficie également d'une liaison régulière par TER (Train express régional) avec Perpignan à l'est et Villefranche-de-Conflent à l'ouest (puis avec Bourg-Madame et Latour-de-Carol par la Ligne de Cerdagne). Cependant, si le trajet Perpignan-Prades dure environ trente minutes, celui jusqu'à Latour-de-Carol est beaucoup plus long (plus de trois heures) avec correspondance à Villefranche-de-Conflent.
Des services de car assurent également la liaison avec plusieurs communes des environs.
Histoire
La première mention du lieu date de 843. C'est à cette date que Charles le Chauve fait donation au comte d'Urgell et Cerdagne alors en place de la villa de Prada. Le comte fait don de la villa à l'Abbaye Sainte-Marie de Lagrasse vers 855. Prades devient alors seigneurie de Lagrasse, statut que le village conservera jusqu'à la Révolution2.
Il est fait mention au XIe siècle de l'actuelle église paroissiale Saint-Pierre3.
Au XIIIe siècle la ville se dote d'une enceinte fortifiée, qui sera renforcée au XVIe siècle avant d'être plus tard démantelée4.
Pau Casals, célèbre violoncelliste, y trouve refuge en 1939 alors que la chute de la République espagnole était proche. Dans les années qui suivent, il s'intéresse au sort des nombreux républicains espagnols exilés dans la région.
En 1950 il crée à Prades le festival de musique (qui porte désormais son nom) auquel il participa jusqu'en 1966, et qui permit des rencontres musicales devenues légendaires entre les plus grands instrumentistes de l'époque.

En 1955 est créé le premier Ciné-Club de la ville sous l'impulsion de Louis Monestier, alors maire de la ville, et Marcel Tariol.
En 1959, sous l'égide de René Clair, Pablo Casals, Président d'Honneur, sont créées Les Rencontres Cinématographiques Internationales de Prades qui ont lieu chaque été, pendant la troisième semaine de juillet. En 2009, l'association Les Ciné-Rencontres de Prades a fêté avec succès les 50 ans du festival.
Enfin, tous les étés depuis 1968, Prades accueille l'Université catalane d'été (en catalan Universitat Catalana d'Estiu).
Lieux et monuments de la ville
L'église Saint-Pierre
Le monument principal de la ville de Prades est l'église paroissiale Saint-Pierre, sise au cœur du centre ancien. Dépendant de l'abbaye de Lagrasse, les parties les plus anciennes de l'édifice remontent vraisemblablement au XIIe siècle, bien que son origine remonte au moins au XIe siècle.
L'augmentation de la population du village rendit l'édifice roman trop exigu, et au début du XVIe siècle, il fut remplacé par l'édifice actuel, achevé au XVIIIe siècle. Seul le clocher roman fut conservé.
L'église conserve un mobilier baroque, dont le retable du maître autel considéré comme étant l'un des plus grands de France. Il est dû au sculpteur catalan Joseph Sunyer, et fut terminé en 169911.

Autres curiosités
En face de l'église s'élève la Maison Jacomet, dont la construction remonte au XVe siècle. Elle fut ensuite remaniée à plusieurs reprises, avant d'être restaurée à la fin des années 1990 et inscrit sur la liste des monuments historiques en 200112.
On notera également la chapelle Saint-Martin de Canoha (Sant Marti de Canoa). L'édifice, qui consiste en une nef unique voûtée en berceau (apparemment refait) terminée par une abside en cul-de-four, peut être daté du XIe siècle. L'église est propriété privée13,14.
Plaine du Roussillon Pyrénées Orientale
![]() francal
11/10/2012
francal
11/10/2012
La plaine du Roussillon est une région naturelle des Pyrénées-Orientales, entre les Aspres, le Ribéral et les Fenouillèdes à l'ouest, les Corbières maritimes et la Salanque au nord, le massif des Albères et la Côte Vermeille au sud, et la mer Méditerranée à l'est.
Elle est délimitée par des barrières naturelles : la chaîne des Corbières, au nord; celle des Pyrénées, au sud; le massif du Canigou, à l'ouest; et, à l'est, la Méditerranée.
Ville principale : Perpignan
Entre terre et mer, le Soleil honore la Plaine du Roussilon de sa présence près de 300 jours par an. Aussi, sur ces terres riches, grasses ou limoneuses, entrecoupées d'étendue rocailleuses, l'activité agricole domine. La plaine s’étend jusqu’à la mer Méditerranée, le long des plages sablonneuses de Canet-en-Roussillon, St Cyprien ou encore Ste Marie la Mer. Au sein d’un environnement préservé, ces stations ont le Canigou et les Albères pour toile de fond.
Cette terre est également celle de chefs d’œuvres de l’Art Roman : le tympan du Maître de Cabestany, la Cathédrale et le cloître médiéval d’Elne…
Cité de Carcassonne Aude Languedoc-Roussillon
![]() francal
23/08/2012
francal
23/08/2012
La Cité de Carcassonne est un ensemble architectural médiéval qui se trouve dans la ville française de Carcassonne dans le département de l'Aude, région du Languedoc-Roussillon. Elle est située sur la rive droite de l'Aude, au sud-est de la ville actuelle. Cette cité médiévale fortifiée, dont les origines remontent à la période gallo-romaine, doit sa renommée à sa double enceinte, atteignant près de 3 km de développement et comportant cinquante-deux tours, qui domine de manière spectaculaire la vallée de l'Aude. La Cité comprend également un château (le château comtal) et une basilique (la basilique Saint-Nazaire).
Sauvée de la destruction par l'action et la tenacité de l'archéologue Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, puis restaurée au XIXe siècle de manière parfois controversée sous la direction de Viollet-le-Duc puis de Boesvillwald, la Cité de Carcassonne est, depuis 19971, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le château comtal, les fortifications, et les tours appartiennent à l'État et sont gérés par le centre des monuments nationaux2, tandis que les lices3 et le reste de la Cité font partie du domaine municipal.

La Cité de Carcassonne est située sur la rive droite de l'Aude en surplomb de la ville de Carcassonne située à l'ouest. Elle se trouve entre la Montagne noire et les Pyrénées sur l'axe de communication allant de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. La présence des deux montagnes forme le couloir carcassonnais souvent cité lorsque les climatologues parlent du vent qui souffle dans ce couloir4. Cet emplacement est donc un lieu stratégique du sud de la France permettant de surveiller cet axe de communication majeur : au Nord vers la Montagne Noire, au Sud vers les Corbières, à l'Ouest vers la plaine du Lauragais et à l'Est la plaine viticole vers la Méditerranée5.
La Cité est construite au bout d'un petit plateau constitué par le creusement de l'Aude à environ 150 mètres d'altitude au-dessus de la ville basse6. La première enceinte construite par les Wisigoths suit les dépressions du terrain7. Ce plateau se détache du massif des Corbières sur la commune de Palaja à 260 m d'altitude, passe dans la Cité à 148 m et finit sa course dans l'Aude à 100 m8. Du côté Ouest, la pente est assez raide offrant un accès difficile à d'éventuels assaillants. À l'Est, la pente est plus douce et permet un accès aisé des marchandises, mais aussi des attaquants. Aussi, les plus importants mécanismes de défense se trouvent de ce côté de la Cité.
2 500 ans d'histoire
La Cité a été successivement un site protohistorique, une cité gallo-romaine, une place forte wisigothe, un comté, puis une vicomté, puis finalement une sénéchaussée royale. Chacune de ces étapes, entre la période romaine et la fin du Moyen Âge, a laissé des témoignages dans les bâtiments qui la composent.

La vie dans la Cité
La vie dans la Cité a été étudiée par de nombreux historiens. À l'époque féodale, la famille Trencavel est riche grâce à ses terres et divers droits et la vie des seigneurs et de l'entourage de la cour est assez faste. Le château comtal est élégamment décoré et le lieu attire de nombreux troubadours106. La vie de la Cité est rythmée par les foires et les marchés. C'est en 1158 que Roger de Béziers autorise deux foires annuelles durant laquelle la protection des marchands et des clients est assurée par le vicomte. Une monnaie locale107 prouve la vitalité et la richesse de la Cité108. Le commerce y est important et fait vivre de nombreuses personnes. La nourriture est abondante et variée : porc salé, pain de froment, brochet, choux, navet, fèves, etc109..
À l'époque royale, la Cité n'est plus aussi active. Les garnisons ont désormais un rôle prépondérant. Le roi met en place l'institution des sergents d'armes. Il s'agit de soldats qui ont pour mission de garder la Cité. Ils sont commandés par un connétable qui fixe les tours de garde et les surveillances diverses des sergents110. Le nombre d'hommes initialement de 220 décline à 110 au XIVe siècle. Ces « sergenteries » deviennent héréditaires en 1336111. Un texte de 1748 décrit avec précision le cérémonial de la mise en place des patrouilles et des gardes. Il décrit aussi les avantages et inconvénients de cette fonction. Les soldats étaient rémunérés par une solde perpétuelle qui conférait à la garnison le nom de "mortes-payes"112. La Cité était aussi bien pourvue en armes de défense et de guerre. Un inventaire de 1298 décrit des machines de jet comme des espringales, des balistes et des mangonneaux, du matériel de siège comme des poutres, des hourds démontés et tout ce qu'il faut pour faire du travail de sape, du matériel de transport comme des chars, du matériel de bâtiment avec de nombreuses pièces de rechange et du matériel d'alimentation notamment pour stocker de l'eau, important en période de siège113. Elle servit ainsi de réserve pour alimenter les diverses batailles qui eurent lieu dans la région.
Lorsque la ville basse s'est développée au détriment de la ville haute, les conditions de vie dans la Cité changèrent énormément. Au XIXe siècle après l'abandon de la Cité par les militaires, la Cité enfermée dans sa double enceinte, devient un quartier abandonné où se concentre la misère114. Seuls les tisserands pauvres vivent dans les lices dans des masures adossées aux murailles dans des conditions d'hygiène dignes du Moyen Âge. À la fin du XIXe siècle les occupants des maisons qui occupaient les lices sont progressivement expropriés et les lices restaurées dans leur état original. Viollet-le-Duc voit cette action comme une opération de nettoyage. La population chassée déménage alors en partie dans la ville basse et en partie à l'intérieur des murs de la Cité.
De nos jours, à l'intérieur de la Cité, la vie quotidienne n'est pas toujours facile. Les ruelles sont étroites, difficiles d'accès et les habitations sont vétustes, mais l'authenticité des lieux attire de nombreux visiteurs115. La Cité possède plusieurs hôtels dont un hôtel de luxe, l'« hôtel de la Cité116 », une auberge de jeunesse117, et de nombreux restaurants et boutiques de souvenirs.
Un haut-lieu touristique
Dès le XIXe siècle, la Cité de Carcassonne attire de nombreux érudits. Ainsi, en 1905, 8 366 étrangers viennent visiter la Cité entre juillet et octobre120. En 1913, 50 000 touristes sont recensés121. La Cité de Carcassonne devient au fil des années un lieu touristique très fréquenté. Des boutiques et des commerces s'installent dans la Cité et de nombreuses cartes postales sont éditées.
Cet afflux touristique est un atout économique certain pour la ville de Carcassonne. Mais, cette fréquentation, dont le pic est estival, a également de nombreux impacts négatifs sur le paysage, les infrastructures, l'architecture et la vie de la commune. Pour améliorer l'accueil des touristes et pour préserver l'environnement et les infrastructures, la ville de Carcassonne et le ministère de l'Écologie et du Développement durable ont mis conjointement en place un programme d'actions appelé opération grand site122. Cette opération vise à réhabiliter et à mettre en valeur la Cité et ses abords.
Aujourd'hui la communauté d'agglomération du Carcassonnais cherche à augmenter les revenus générés par les visiteurs de la Cité de Carcassonne. Le problème majeur est que le flux de touristes limite son séjour à la visite de la Cité où il passe une durée moyenne de quatre heures. La ville basse ne bénéficie que très peu de l'attrait de la Cité, car cette dernière est un but d'excursion et non un lieu de vacances123. Les visiteurs privilégient les courts séjours de 1,5 jour essentiellement en hébergement hôtelier et fréquentent peu les résidences de tourisme et les campings locaux. Les visiteurs se répartissent entre vacanciers des stations balnéaires situées sur la côte, locaux pratiquant un tourisme de proximité et étrangers visitant la Cité dans le cadre d'un tour d'Europe. Cependant, la Cité reste sur le plan touristique un « produit d'appel » pour le reste de l'Aude, le Pays Cathare et le Carcassonnais. Depuis mars 2008, une adjointe au maire est chargée spécialement de la Cité et de l'opération grand site.
Chaque année, la ville organise diverses animations au sein de la Cité :
- Le festival de la Cité se déroule chaque été dans le théâtre Jean Deschamps au cœur de la Cité et permet de découvrir plusieurs pièces de théâtre, opéra ou concerts124.
- L'embrasement de la Cité se déroule tous les ans le 14 juillet et constitue un feu d'artifice unique en son genre attirant chaque année près de 700 000 spectateurs125.
- Le marathon de la Cité se déroule dans le cadre la Cité de Carcassonne et de ses alentours chaque début d'octobre126.
- Les Médiévales sont un spectacle de reconstitution médiévale qui se tient au mois d'août et comporte des animations de rues et des tournois de chevaliers dans les lices.
Seule la fréquentation touristique du château comtal et des remparts est aujourd'hui décomptée de façon statistique puisqu'il s'agit des seules visites payantes