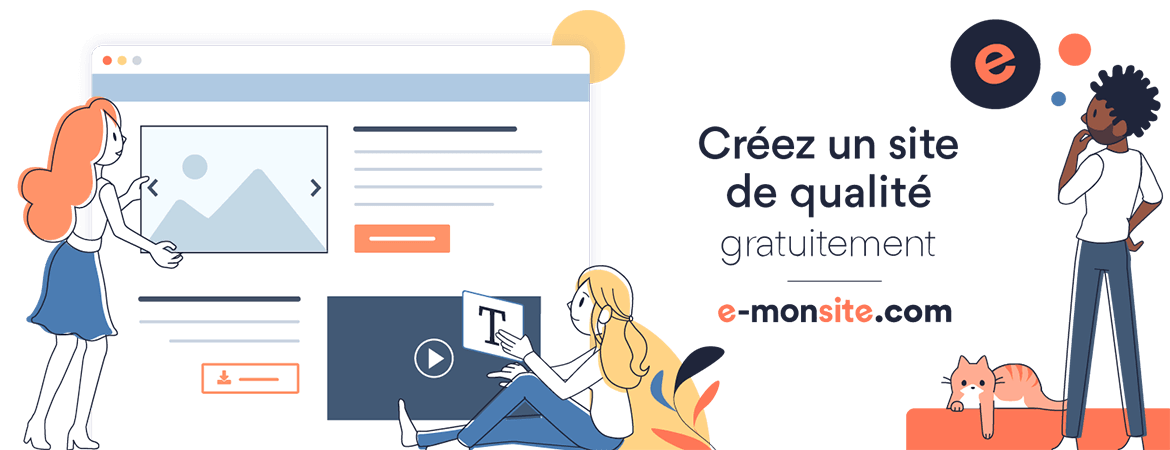Un ancien lieu druidique
Au centre du canton et sur le territoire de Lapoutroie s'élève le pic dit lo Faudé, que l'on croit avoir été anciennement un lieu consacré aux mystères du culte druidique. Ce qui confirme cette opinion, c'est que le nom qu'il porte signifie dans la patois du pays le faux Dieu. Son sommet est en outre couronné d'immenses rochers, semblables aux autels druidiques, et qu'on y remarque un emplacement appelé Tschénor (chat noir), où l'on a découvert des ossements humains, tristes débris, sans aucun doute, des sanglants sacrifices perpétués dans cet endroit.
Le canton traversé par une ancienne voie romaine
Le canton de Lapoutroie fut sans nul doute traversé par une antique voie romaine qui prenait naissance au Bonhomme pour s'achever à Fréland, en suivant la direction des montagnes et en passant au-dessus de Ribeaugoutte. Cette voie a une parfaite ressemblance avec celle que l'on peut observer sur la montagne du mont Sainte-Odile. On y a trouvé dans les champs qui l'avoisine, des armes d'époque et des pièces de monnaies à l'effigie des empereurs romains;
 La première mention du village
La première mention du village
En 842 Lapoutroie connue sous le nom de Sconerloch fait partie du royaume de Lothaire Ier. Il s'agissait alors d'un village essentiellement de charbonniers. Un acte de l'année 1047 du couvent de Sainte-Croix-en-Plaine fait mention de biens à Sconerloch.
Deux ans plus tard, l'abbesse du couvent de Sainte-Croix-en-Plaine, sœur du pape Léon IX fait construire la première église dans la localité. La première mention du village date de l'année 1090. Il faisait alors partie de la seigneurie de Hohnack et du bailliage du Val d'Orbey, située près de Labaroche et appartenant au comte d'Eguisheim.
Lapoutroie devient le centre administratif du bailliage. Le prévôt du val, chargé de rendre la justice y réside. Au XIIe siècle le village de Lapoutroie est toujours cité sous le nom de Sconerloch comme le relève un document du couvent de Sainte-Croix fondé par le pape Léon IX.
La seigneurie du Hohnack
Les Ribeaupierre, dont le siège est Ribeauvillé firent le siège du château du Hohnack commune de Labaroche en 1279 et 1288. Ils s'en emparèrent. La seigneurie a appartenu successivement à la famille d'Eguisheim, aux comtes de Ferrette puis Habsbourg. Les Ribeaupierre étaient les vassaux et rendaient foi et hommage à cette seigneurie.
Une dépendance des Ribeaupierre
De 1348 à 1536 Lapoutroie fait partie de la seigneurie de Ribeaupierre et le représentant de la seigneurie habitait dans les lieux, et on y trouvait aussi une prison et un tribunal. Les criminels furent pendus à Hachimette et le gibet se trouvait sur un pré en face de la chapelle. Les habitants payaient d'ailleurs la dîmes et autres redevances au couvent Sainte-Croix dont l'abbesse nommait le curé de la paroisse.
Après la disparition du couvent la dîme passe à la ville de Colmar qui vendit en 1568 ses droits à l'abbaye de Pairis. C'est à Lapoutroie que réside le prévôt représentant les Ribeaupierre pour faire régner la justice.
 Pillage, invasion, guerres privées et famine
Pillage, invasion, guerres privées et famine
En 1298, l'évêque de Strasbourg tente de s'emparer du Val d'Orbey et livre une guerre opiniâtre contre Thibaut de Ferrette. Entre 1347 et 1350, la peste noire décime plus d'un tiers de la population.
En 1365 ce sont les Grandes Compagnies qui ravagent la région faisant de nombreuses victimes.Vers 1385 et 1386 la famine vient s'ajouter aux lots de malheur que connaît la population. Entre 1365 et 1375 la région connait des incursions des troupes de Lorraine qui livrent bataille avec ceux des Ribeaupierre bien décidés à protéger leur pré-carré.
Puis ce sont les troupes de la ville de Colmar qui essayent de s'emparer de Lapoutroie, mais les Ribeaupierre parviennent à les contenir et à les mettre hors la loi en 1495.
La révolte des paysans
À partir de 1493, et à plusieurs reprises, les paysans se révoltent contre les seigneurs qui les accablent d'impôts alors qu'ils sont en situation de précarité. La cherté de la vie et le manque de nourriture provoquent des disettes et parfois des famines.
Le lundi de Pâques 1525 les paysans se soulèvent, mobilisant de 30000 à 40000 hommes venant de toute l'Alsace sous la conduite d'Erasme Gerber. Ils s'attaquent à l'abbaye de Pairis et s'emparent des villes comme Kaysersberg ou Ribeauvillé. Les seigneurs pris de panique appellent à l'aide le duc de Lorraine qui craignant la contagion en Lorraine va mater la résistance des paysans à Scherwiller où l'on dénombra plus de 6000 morts.
Cependant, les paysans réussissent à conserver leurs droits et coutumes. En 1536, la ville de Colmar conquiert le droit de collation et les biens du couvent de Sainte-Croix-en-Plaine, donne la cour et la dîme en location, puis la vend en 1668 à l'abbaye de Pairis.
Les ravages de la Guerre de Trente Ans
Le village est ravagé pendant la guerre de Trente Ans. Vers 1632 on dénombrait encore 206 habitants, en 1635 la population tombe à 256 ménages puis en 1681 il ne restait plus que 36 occupants et 30 maisons. En 1648 il ne reste que 96 foyers, soit une chute vertigineuses de 66 %. Les Suédois ou les « houèbes » comme on les appellent dans la région, sèment la mort, la désolation et la ruine sur leur passage.
À Hachimette, le hameau de Lapoutroie, il ne restait plus que 10 habitants et 8 maisons, à la Goutte 9 habitants et 5 maisons et à Ribeaugoutte 27 habitants réparti dans 22 maisons. La même année le hameau de Ribeaugoutte fut pratiquement décimé par un incendie qui emporta 18 maisons.
Le repeuplement de la région
La guerre de trente ans terminé, Louis XIV fait circuler en Lorraine des émissaires appelant des volontaires à venir repeupler la région décimée par les hordes suédoises. C'est de Remiremont que viennent en majorité les volontaires. D'autres personnes venant du Tyrol, alléchés sans doute par la promesse de terres et de fermes données gratuitement répondent à l'appel.
À partir de 1700, la région recommence à se repeupler. On comte déjà de 600 à 700 âmes qui se fixent définitivement à Lapoutroie. On retrouve des patronymes déjà installés en Lorraine comme les Ancel, Baradel, Collin, Didierjean, Dodin, Mathieu, Marco, Batot, Lamaze, Blaise, Mathis, Flayeyx, Haxaire, Finance, Fréchard, Martin, Miclo, Vilmain, etc. De Tyrol et de Thuringe arrivent des familles entières pour repeupler la commune : les noms de famille sont essentiellement les Firer, Trischler, lantz, Kerle Wittchker et Witwehr.
Le village sous la domination française
Après le traité de Westphalie en 1648, les seigneurs du Hohnack, initialement vassaux de Habsbourg, sont placés sous la suzeraineté du roi de France. Lapoutroie devient le chef-lieu du canton en 1796.
La Révolution
En 1732, le village compte 876 habitants. Vers 1780, les tensions s'aggravent dans les campagnes. L'impôt royal devient de plus en plus lourd et double même entre 1770 et 1789. Le mécontentement grandit. Les paysans forment des bandes, attaquent et pillent les couvents. L'annonce de la prise de la Bastille déclenche de véritables émeutes.
La Révolution est accueilli avec soulagement par la population. Dans les mois qui suivent, l'Assemblée constituante procède à de profondes transformations. L'Alsace est divisée en deux départements, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, sept district dont celui de Colmar et 58 cantons dont celui de Kaysersberg auquel appartient Lapoutroie.
Le Conseil souverain est supprimé, les corporations et corps de métiers abolis, les biens de l'église sont nationalisés et vendus aux enchères, les paysans sont délivrés des charges seigneuriales et de la dîme. Lapoutroie devient chef lieu du canton en 1796.
L'industrialisation
Avec le développement de l'industrie en 1850, des industries voient le jour dans la commune. Une filature de coton, deux fabriques de cretonne, quatre moulins, une brasserie, deux huileries et deux scieries sont installés. La population passe alors à 3206 habitants.
Un gigantesque incendie
Le 2 septembre 1750, un violent orage s'abat sur le village. La foudre met le feu sur une maison proche de l'église. La maison en feu communique à plusieurs autres maisons dont l'église qui est réduit en cendre. La sacristie et le chœur, ainsi que les autels latéraux protégés par leurs voûtes sont épargnés par le feu. Pas moins de 22 maisons et deux granges partent en fumée.
Pour secourir les sinistrés, l'évêque de Bâle organisa une quête en faveur des sinistrés. L'intendant de Strasbourg demanda le 9 février 1751 aux baillis et magistrats des villes et communes de Kientzheim, Ammerschwihr, Sigolsheim et Munster de faire couper 500 troncs de chêne et 1 050 troncs de sapins qui furent répartis aux sinistrés de Lapoutroie par le bailli Fuchs de Ribeauvillé. Ils servirent à reconstruire l'église, les maisons et les autres bâtiments du village.
Le conseil de fabrique fit don de 3 000 livres, ce qui permet de restaurer la nef de l'église. L'abbaye de Pairis est contraint, en vertu d'une condamnation, de faire rebâtir à ses frais le chœur. Grâce à toutes ces interventions, l'église fut consacrée le 13 juin 1760 par Joseph Guillaume de Rinck, prince-évêque de Bâle.
L'école aux XVIIe et XVIIIe siècles
La communauté de Lapoutroie semble disposer d'écoles dès la fin du XVIIe siècle. Le plus souvent il s'agissait de bâtiments ordinaires plus ou moins aménagés pour un usage scolaire. À la fin du XVIIe siècle il est envisagé la construction d'une nouvelle école plus spécieuses répondant pour recevoir le nombre toujours plus important d'élèves.
Le décret du bailli de Lichtenberg du 20 avril 1773 organise la vie scolaire dans la seigneurie des Ribeaupierre. Il rend l'école obligatoire dès l'âge de sept ans jusqu'à ce que les élèves sachent lire et écrire. Les parents sont tenus d'envoyer leur progéniture à l'école sous peine de quatre sols par semaine d'amende. Le produit de ces amendes sont destinés à être distribué en récompense aux élèves studieux.
Le même décret punit les parents ou les maîtres dont les enfants n'assistent pas régulièrement à l'enseignement religieux (jusqu'à 14 ans en général) d'une amende de deux sols chaque fois. Le maître doit enseigner aux enfants la lecture, l'écriture, le plain-chant, le catéchisme. Il doit apprendre aux enfants à lire le français et le latin afin qu'il puisse participer à réciter des prières en latin.
En 1690 une ordonnance stipule que le maître d'école s'engage à ne pas boire d'alcool et à ne pas fréquenter les cabarets. Il a aussi le devoir de corriger les élèves quand ceux-ci le méritent.L'instituteur a également des fonctions plus proches de celles d'un sacristain: il doit assister à toutes les processions ainsi qu'à tous les offices. Il est chantre et doit assister de bonne heure à l'église et aider les autres chantres et les servants de messe. Il doit aider le marguillier et régler l'horloge de l'église. Il doit aussi assurer le blanchissage des linges de l'église et peut être amener à fabriquer des cierges, des hosties, etc..
Le maître d'école touche des indemnités diverses pour les différentes tâches exercés dans le cadre de son activité. Il touche en outre un droit d'écolage qui se monte à 6 rappes par enfant et par semaine en 1709. À Lapoutroie en 1750, chaque élève doit payer 1 sol et 4 deniers. Pendant l'hiver, de la saint-martin (11 novembre) à Pâques, chaque élève doit apporter une bûche de bois pour le chauffage de l'école. Les élèves qui ne le font pas doivent payer au maître 12 sols.
Ce droit d'écolage représente une somme importante pour le maitre d'école. Le maître d'école touche six cordes de bois. Il peut garder garder trois cordes et toucher le reste en argent.Il est le plus souvent logé par la communauté. son logement comporte généralement un poêle avec un jardin, une cuisine, deux chambres, une cave d'un emplacement pour l'écurie pour y loger les vaches, de la place pour le foin et le bois de chauffage. La communauté a le pouvoir de révoquer le maître.
Le 15 octobre 1702 la communauté de Lapoutroie révoque Dominique Menetrez. Souvent des excès sont commis par la communauté sans rapport avec la valeur pédagogique. C'est pour remédier à ces excès, que l'intendant d'Alsace Louis Guillaume de Blair, promulgue par ordonnance le 6 octobre 1774, lue et publiée à l'issue de la messe paroissiale le 30 octobre. L'intendant ordonne que les prévôts, bourgmestres et préposés des communautés remettent au Bailli du département, tous les actes concernant les accords ou engagement des maîtres. Il est désormais interdit de congédier les instituteurs sans y avoir été autorisé par l'intendant.
En 1851, les notables fuient la fureur des paysans
En 1851, lors de l'émission des billets du lingot d'or, quelques habitants notables de Lapoutroie, constatant la fureur avec laquelle les paysans de la localité accaparèrent les billets, résolurent d'essayer de faire rester dans la localité les pièces d'un franc que le public jetait dans le gouffre; il organisèrent une loterie au profit des pauvres; l'un d'eux avança l'argent nécessaire pour acheter des lots.
Leur opération laissa un bénéfice de plus de 500 francs, qui firent le premier fond d'un bureau de bienfaisance, dont la création fut sollicitée et autorisée.
La guerre de 1870
Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Mal préparé, mal commandé, l'armée française ne fera pas le poids face aux troupes prussiennes. Le 4 août, les régiments français sont battus à Wissembourg, le 28 Strasbourg capitule. L'armée française est vaincue à Sedan le 2 septembre. Le 4 octobre est proclamé la fin de l'Empire et l'avènement de la république.
L'Alsace et la Moselle sont purement et simplement annexées le 10 mai 1871. En juin 1871 le territoire est proclamé pays d'Empire (Reichsland). Le village est baptisé Schnierlach. Jusqu'en 1900 le français est toléré comme droit local. En 1872, le service militaire devient obligatoire. Un certain nombre de personnes quittent alors Lapoutroie pour échapper au service militaire obligatoire en s'installant dans les Vosges ou d'autres régions françaises.
La première guerre mondiale
Le 31 juillet 1914, le Reichsland est déclaré en état de danger. Tout fonctionnement de la vie courante est soumis à autorisation. Le lendemain 1er août l'ordre de mobilisation est décrété. Le lundi 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France.
Le 15 août l'artillerie française bombarde le col du Bonhomme, l'église et une vingtaine de maisons sont brûlées. Le 16 août, les troupes françaises, bousculant les troupes bavaroises font leur entre à Lapoutroie où la population leur réserve un accueil délirant. Lapoutroie est momentanément redevenue française. Le 2 septembre, l'armée allemande composée de régiments bavarois contre attaque et s'empare à nouveau de Lapoutroie. Les chasseurs alpins français se replient à la Tête des Faux.
Dans la région, le Linge et la Tête des faux contrôlent le passage du Col des Bagenelles et celui du Bonhomme qui seront âprement disputés. Le soir du 15 juillet 1915, la tour du Faudé criblée d'éclats d'obus s'écroule. Les tir de l'artillerie française menace toute la région. Le 22 juillet 1916, un bombardement de la gare d'Hachimette fait plusieurs morts. 23 civils seront tués pendant la guerre, parmi lesquels des enfants.
Au cours des combats la commune sert de base aux troupes allemandes qui combattent à la Tête-des-Faux. Peu à peu, à partir de 1915, le front des Vosges sera plus calme et le restera jusqu'en 1918. Le 17 novembre 1918, les troupes françaises font leur entrée officielle à Lapoutroie que les allemands avaient désertés quelques jours plus tôt. Le 11 novembre 1918, l'armistice met fin à la guerre et l'Alsace et la Moselle redeviennent française. L'économie se met péniblement en marche.