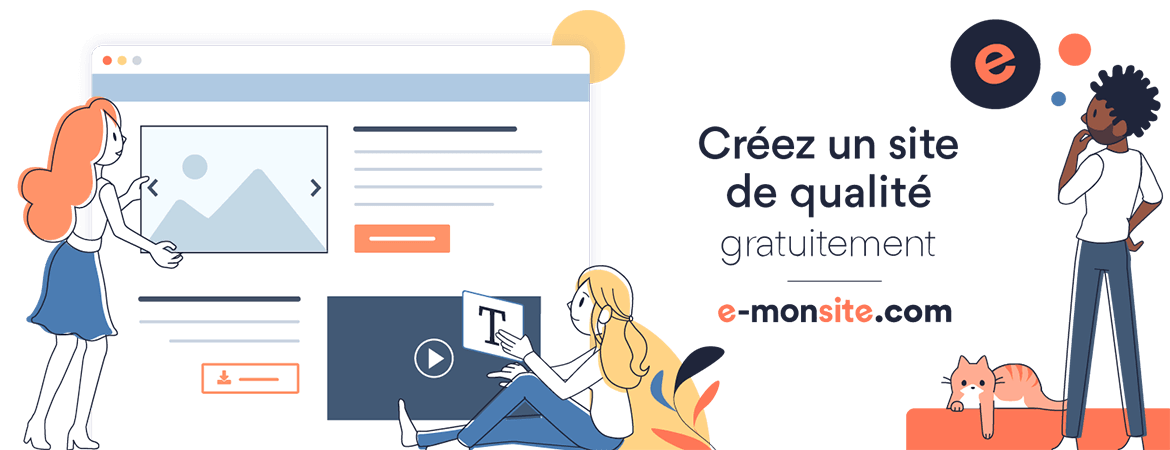Provence-Alpes-Côte d'Azur
Abbaye de Valsaintes Alpes de Haute Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Par francal
- Le 09/11/2012
- Commentaires (0)
- Dans Provence-Alpes-Côte d'Azur
Un jardin, une église, une terre de mémoire
Esprit de Valsaintes

Un cheminement conduisant à découvrir son histoire sacrée.
Le Saut du Moine Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Par francal
- Le 08/11/2012
- Commentaires (0)
- Dans Provence-Alpes-Côte d'Azur
Légende du Saut du Moine
Le rocher surplombant le confluent de la Romanche et du Drac tire son nom, dit-on, d’un drame passionnel.
On raconte qu’un moine novice nommé Jehan Godemard tomba amoureux de Marie Trahan, jeune fille du plateau. Oubliant sa vocation, il chercha à la séduire en revêtant des vêtements qui ne trahissaient pas ses vœux. La pauvre Marie commença à nourrir un doux sentiment à son égard, jusqu’au jour où elle le croisa en robe de bure. Désespérée, elle se jeta dans le vide du haut du rocher, entraînant le moine dans sa chute.
La légende en vers
Il était une fois, dit une vieille histoire,Dans un sombre couvent de moines augustins,Un novice qui, seul, venait tous les matinsPréparer sur l’autel la nappe et le ciboire.C’était le fils cadet d’un duc de sang royalVoué par cela même à porter la tonsure.Or, chaque jour, avant l’office matinal,Priait dans la chapelle une enfant belle et pure.Le diable, qui rôdait par là,Ricanait en voyant cela.Comme vous le pensez, les yeux du jeune moineDu côté de la grille allaient errer souvent,Et parfois il faisait quelques pas en avantVers la rêveuse enfant blonde comme l’avoine.Or la belle filait, un soir, à son fuseau.Au dehors il faisait un temps épouvantable.Un jeune voyageur couvert d’un long manteauVint demander asile au foyer charitable.Le diable, qui rôdait par là,Ricanait en voyant cela.On le fit vite entrer, on raviva la flamme,La mère lui servit un bouillon tout fumant,Le père lui versa d’un bon vin ranimant,La belle dans ses yeux laissa parler son âme.Il leur dit que d’un prince il était messager,Et pourrait d’autres fois s’arrêter au passage.Vous l’avez deviné, le galant étranger,C’était notre novice échappé de sa cage.Le diable, qui rôdait par là,Ricanait en voyant cela.Il revint en effet souvent, à la nuit close,Et ne fut pas longtemps sans dire son amour.Pour un si doux aveu la fillette, en retour,Avoua que son creur ne rêvait d’autre chose.Pour elle, l’amoureux, c’était un fiancé.Par des serments trompeurs il gagnait sa tendresse,Et les parents, heureux de le voir empressé,Aussi bien que leur fille accueillaient sa promesse.Le diable, qui rôdait par là,Ricanait en voyant cela.Survint la Fête-Dieu. Portant croix et bannières,Dans les chemins, manants et Pères défilaient.Seule la blonde enfant, que des songes troublaient,Devant l’autel désert s’abîmait en prière.Par crainte d’être vu le moine était resté.Il était inquiet, passait de place en place,Quand un cri déchirant tout à coup fut jeté :Car les deux amoureux se trouvaient face à face.Le diable, qui rôdait par là,Ricanait en voyant cela.Les yeux hagards, les bras levés, comme une folle,Elle s’enfuit, courut d’abord vers les maisons,Puis dans les champs, dans les chemins, dans les moissons.Ses cheveux déroulés flottaient en auréole.Traversant les guérets, franchissant les ruisseaux,Derrière elle le moine à grandes enjambéesCourait, faisait des bonds à se rompre les os,Les yeux ardents déjà d’infernales flambées.Le diable, qui rôdait par là,Ricanait en voyant cela.Cette fuite affolée avait troublé la fêteEt le Père prieur ne savait qu’en penser.Quel scandale affreux ! Qu’allait-il se passer ?Il demeurait stupide en se grattant la tête.Le novice gagnait du terrain. C’en est fait,Il l’atteint, la saisit par sa robe envolée ;Elle s’échappe encor, tombe ; tout disparaît.La terre sous leurs pieds serait-elle écroulée ?Le diable, qui rôdait par là,Ricanait en voyant cela.Ils étaient tous les deux tombés dans la Romanche,Du haut des grands rochers taillés dans les côteaux.Les premiers arrivés virent sortir des eauxEt monter vers le ciel une colombe blanche.Mais le moine est resté dans les flots écumants,Il se débat encor dans l’eau qui tourbillone,Et la voix du torrent, dans ces gouffres fumants,Etouffe les clameurs de sa bouche félonne.Le diable, qui rôdait par là,Ricanait en voyant cela.
Colorado provençal les ocres de Roussillon Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Par francal
- Le 08/11/2012
- Commentaires (0)
- Dans Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le Colorado provençal ou ocres de Rustrel est un site semi-naturel, puisqu'il fut exploité depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'en 1992 où le dernier ocrier prit sa retraite. Le site est situé sur la commune de Rustrel dans le département de Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les paysages insolites qu'il offre sont constitués de sable ocreux d'origine latéritique.
Le Colorado provençal s'étend sur plus de 30 hectares. Ses sentiers en terre permettent de découvrir des falaises érodées comprenant plus de 20 teintes d'ocre. Le « cirque de Barriès », le « cirque de Bouvène », les bassins de décantation, les cheminées de fée, le « Sahara », les tunnels, le lit de la Dôa (la petite rivière locale) offrent des décors variés aux randonneurs. Le chemin de grande randonnée GR 6 traverse le site.
Il y a plusieurs millions d’années, la mer se retire en laissant derrière elle des bancs de sables enrichis d'une argile ayant pour particularité de contenir du fer, la glauconie.
Le Roussillonnais Jean-Étienne Astier eut l'idée, à la fin du XVIIe siècle, de faire passer le sable dans des bassins de décantation pour en extraire l'ocre. Il le fit ensuite cuire pour en garder les propriétés colorantes. Six départements possédaient alors des gisements : le Vaucluse mais aussi le Cher, la Drôme, le Gard, la Dordogne et l'Yonne. L'arrivée du chemin de fer à Apt en 1877 permit l'exploitation intensive dans le Vaucluse. Créée en 1901, la Société des Ocres de France permit le développement du marché vers l'exportation. Les maxima de production furent atteints en 1929.
L'arrivée des colorants synthétiques vint progressivement concurrencer les ocres naturelles. Après un long déclin, l'exploitation des sites d'extraction s'arrêta peu à peu. Seul le site de production de Gargas reste en activité. Devant la variété de couleurs et de paysages, une association se forme afin de sauvegarder le site et démarre alors une exploitation touristique.
Géologie, géochimie et origine

Au cours du Crétacé, il y a 110 millions d'années, à la période de l'Aptien, du nom de la ville d'Apt, un grès constitué par des grains de sable s'accumule sur 30 mètres d’épaisseur. Ces sédiments sableux se sont d'abord déposés en milieu marin proche des côtes, dans un environnement prodeltaïque, puis à la même époque le bombement dû au rapprochement de l'Ibérie, a fait émerger ces formations sédimentaires. Ces sables vont être à l'origine de l'ocre, grâce à une argile d'origine exclusivement marine et riche en fer : la glauconie1.
Dans le Colorado de Rustrel, depuis leur dépôt et leur exposition aux conditions atmosphériques, les strates d'ocre ont subi, par processus d'altération de type latéritique, une forte oxydation ayant conduit à la formation d'oxy-hydroxydes et d'oxydes de fer, respectivement appelés goethite (FeOOH) et hématite (Fe|2|O|3|), dont les proportions relatives font varier les nuances de couleurs que ces pigments confèrent aux sables ocreux. Il s'y mêle des sables blancs où domine la kaolinite (Al4Si4O10OH8).

La présence de manganèse, d'aluminium et de silicates sont à l'origine d'autres gammes de couleurs et des 24 teintes officiellement recensées, qui vont du gris au vert, en passant par le jaune et le rouge1. Ces dépôts marins sont surmontés par des dépôts plus grossiers d'origine continentale, dépourvus initialement de glauconie et donc particulièrement blancs, eux-mêmes surmontés encore d'une cuirasse ferrugineuse.
Source wikipédia
les rochers de Mourres Luberon Alpes de Haute Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Par francal
- Le 08/11/2012
- Commentaires (0)
- Dans Provence-Alpes-Côte d'Azur
C'est un des patrimoines naturels uniques en Europe qui fait la fierté des habitants de Forcalquier. Le site des Mourres appartient depuis un an à la commune. Pendant plusieurs mois, des travaux y ont été réalisés afin de mieux appréhender ce lieu protégé.
Histoire de découvrir ces rochers aux formes étranges, ces champignons de pierre, la Ville de Forcalquier organise ce dimanche 24 juin une journée dédiée aux Mourres. Au programme De nombreues animations culturelles mais également es balades instructives...
Carnets de Rando, l'Emission, Spécial Luberon. Itinéraire n°1 : à deux pas de la ville de Forcalquier, dans la partie nord du parc naturel régional du Luberon, se découvre un lieu étonnant, jalonné de pénitents calcaires vieux de plusieurs millions d'années. Cet endroit, unique au monde du point de vue géologique, c'est le plateau des Mourres. Découverte.
Gorges de la Nesque Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Par francal
- Le 07/11/2012
- Commentaires (0)
- Dans Provence-Alpes-Côte d'Azur
Les gorges de la Nesque dans les monts de Vaucluse, entre Monieux et Méthamis, sont un canyon creusé par la Nesque.
Les gorges démarrent au sud de Monieux, juste après le plan d'eau et à une altitude de 625 mètres, pour finir au pied du bourg de la commune de Méthamis, à une altitude d'environ 270 mètres.
Accès
La route départementale 942 permet de les parcourir par les hauteurs avec plusieurs arrêts point de vue dont un « belvédère » (734 m). Ces gorges impressionnantes dont fait partie le rocher de cire Lou Roucas dou Cire ont été chantés par le félibre Mistral. C'est un passage très emprunté par les cyclistes et touristes qui l'apprécie pour sa grande beauté et sa nature préservée.
Le chemin de grande randonnée 9 passe par les gorges.
Géologie

Le massif des monts de Vaucluse est formé de calcaires de l'ère secondaire, souvent perméables. L'eau s'enfonce dans la roche, créant des réseaux souterrains (système karstique), ressortant aux points bas comme la Fontaine-de-Vaucluse, où encore au niveau de la source de la Nesque.
Certaines falaises mesurent plus de 200 mètres de hauteur.
La Réserve de Biosphère du Mont Ventoux
Le site est inclus dans la « Réserve de Biosphère » du Mont Ventoux. Cette réserve de biosphère comprend 6 zones centrales dont celles des gorges de la Nesque dont la diversité des milieux qu'elle offre a permis l'alimentation et la reproduction d'espèces protégée par la loi comme le Faucon pèlerin, l'Aigle royal ou encore la Salamandre tachetée .
Archéologie
Le site du Bau de l'Aubesier a été fouillé dès 1901. Après un temps de latence entre 1964 et 1987, les archéologues, dans le cadre d’un projet franco-canadien et international, ont repris leurs fouilles sous la direction de Serge Lebel de l'Université du Québec à Montréal. La dernière campagne en 2006 a mis en évidence la présence de l'homme de Néandertal et de pré-néandertaliens3.
Les fouilles successives ont livré des vestiges de l'industrie lithique du Moustérien et de nombreux restes d’herbivores où dominaient l’aurochs (43-53%) et le cheval (31-35%). C'est la plus forte concentration européenne de ce dernier, de plus, la présence du renne, toujours rare à l’Est du Rhône, « indiquent que la Provence a constitué une entité biogéographique particulière durant le Pléistocène moyen »3.
Les essences forestières allaient du pin, toujours dominant, au sapin et au genévrier, suivis par des feuillus : hêtre, aulne, noisetier, tilleul. Quant au chêne sa présence était constante3.

L'utilisation du feu dans la grotte a été mise en évidence (silex chauffés, charbons végétaux, résidus cendreux, matières osseuses et dentaires brûlées). Les fouilles ont permis de récolter 2 869 os et dents ainsi que trois fossiles pré-néandertaliens. C'est une découverte majeure qui a montré que ceux-ci « possédaient des comportements sociaux et des habiletés technologiques beaucoup plus avancés que ceux connus jusqu’à aujourd'hui »3.
Source Wikipédia